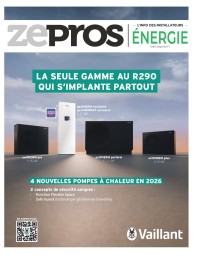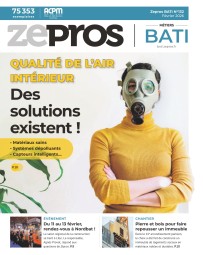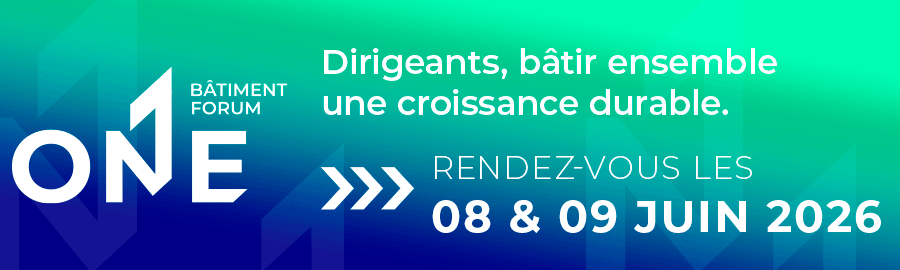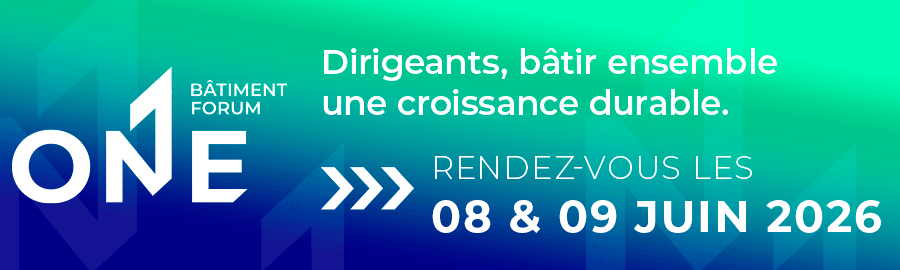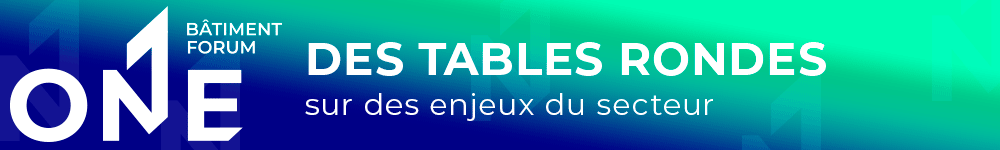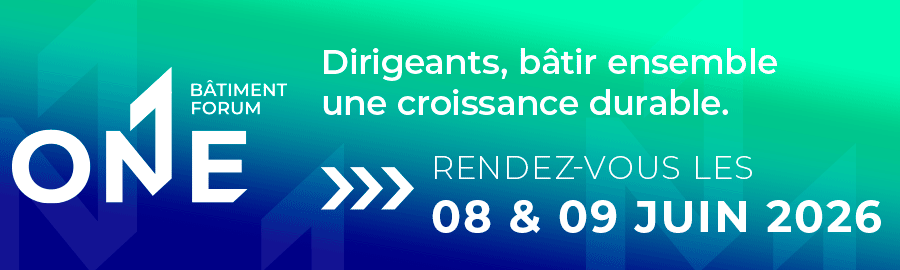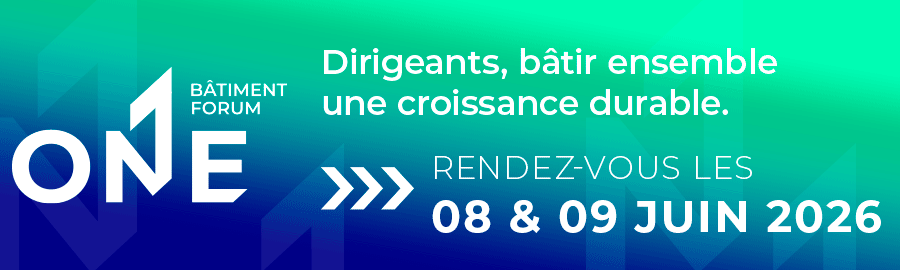« Concilier pilotage de production et sobriété énergétique »

À l'heure où les industriels cherchent à concilier performance, transition énergétique et décarbonation, Aveva mise sur le numérique et l'IA pour transformer les procédés. Guillaume Vray, directeur France, et Joanna Mainguy, directrice Développement durable, détaillent la stratégie du groupe : jumeaux numériques, optimisation en temps réel, IA générative et gouvernance des données. Objectif affiché : réduire les coûts et les émissions, tout en accélérant l'innovation durable.
Comment accompagnez-vous les acteurs du Bâtiment ?
Guillaume Vray : Aveva travaille particulièrement avec le trio "fabricants, constructeurs et bureaux d'études" dans le secteur de l'énergie et du traitement des déchets. Prenons l'exemple d'EDF, dont l'ambition est de réduire l'empreinte carbone de la production d'énergie tout en maintenant un haut niveau de sécurité : l'entreprise utilise nos solutions pour concevoir avec des partenaires comme Omexom, Equans ou encore Parlym la prochaine génération de centrales nucléaires.
Dans ce cas précis, Aveva Unified Engineering et Aveva E3D Design permettent d'accélérer la phase de conception en facilitant la visualisation des projets grâce au partage de données 3D. Autre exemple, celui de Vinci, avec un projet d'usine de traitement des déchets. Pour ce type de projets qui intègrent de plus en plus une dimension de recyclage ou de conversion des déchets en énergie, les infrastructures se complexifient. De la conception à la construction jusqu'à la livraison du bâtiment, l'accès à des données fiables par l'ensemble des parties prenantes est capital.
Votre solution Connect est présentée comme une plateforme ouverte facilitant le partage et l'analyse des données industrielles. Quel est son intérêt, concrètement ?
Guillaume Vray : Que ce soit dans le secteur pharmaceutique, l'agroalimentaire, la chimie, l'énergie, l'industrie manufacturière, l'automobile ou encore l'exploitation minière et la métallurgie, la valeur de Connect en tant que plateforme de données industrielles ouverte et collaborative s'illustre dans de nombreux cas clients.
Chez EDP Renewables, plus de 2 millions de balises de données ont été connectées au cloud via Connect, permettant une analyse à l'échelle de leur parc éolien, une maintenance plus efficace et une gestion unifiée des données à l'échelle mondiale. D'autres entreprises comme Dominion Energy ou encore Acciona utilisent Connect pour le reporting ESG, l'optimisation du traitement de l'eau ou encore la surveillance environnementale prédictive.
Les clients sont unanimes : via ses tableaux de bord en temps réel, ses assistants IA ou ses plateformes d'analyse évolutives, Connect simplifie l'intégration des données, renforce la collaboration entre équipes et partenaires, et libère tout le potentiel des données industrielles.
Connect, PI System et AIM convergent vers des jumeaux numériques et des capacités prédictives. Quelles sont les prochaines étapes ?
Guillaume Vray : Connect repose sur une architecture sécurisée, hybride et évolutive, et offre par défaut des applicatifs et services en mode SaaS accessibles via le modèle d'abonnement Aveva Flex. En utilisant cette plateforme d'intelligence industrielle ouverte et enrichie d'IA, les utilisateurs font l'agréable expérience d'un jumeau numérique intelligent qui rassemble des informations fiables dans leur écosystème d'applications et de partenaires. Nos clients industriels peuvent concevoir le jumeau numérique de leur choix en accédant via Connect à l'ensemble de notre offre logicielle pour combiner les solutions nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs. De plus, comme Connect est une plateforme ouverte, ils peuvent également accéder à des applications tierces.
En tant que leader de l'IA industrielle depuis plus de 20 ans, Aveva développe ses logiciels de sorte qu'ils puissent intégrer les évolutions de l'IA au fil du temps. La plateforme Connect a évidemment été pensée et développée autour de l'IA. Elle intègre des logiciels d'IA reconnus tels que Aveva Advanced Analytics qui permet de créer des modèles IA en libre-service pour optimiser la production, améliorer la qualité, renforcer la fiabilité des actifs et réduire la consommation d'énergie, les émissions et les déchets. Également accessible via Connect, notre Assistant d'IA Industriel basé sur l'IA générative facilite la collaboration et la prise de décision en temps réel : il permet d'interagir avec les données et les systèmes contextualisés en langage naturel via une interface conversationnelle intuitive et fiable grâce à la traçabilité des sources.
Le développement de nouveaux services "AI-as-a-Service" est en cours pour introduire des agents IA autonomes intégrés nativement à la plateforme d'intelligence industrielle Connect. Ces agents, orientés objectifs et spécialisés par domaine (surveillance des actifs, création de jumeaux numériques, analyse à la demande), seront capables de collaborer de manière fluide entre eux et avec les systèmes existants comme notre Assistant d'IA Industriel, tout en intégrant des workflows impliquant des humains.
Notre approche vise à optimiser l'intelligence industrielle en continu et de manière coordonnée et évolutive pour relever les défis complexes de performance, résilience, sécurité et durabilité.
L'intégration d'APS est annoncée comme un levier pour accroître l'efficacité énergétique. Pouvez‐vous partager un exemple chiffré d'un client où APS a permis de concilier pilotage de production et sobriété énergétique ?
Guillaume Vray : L'intégration d'Aveva Process Simulation (APS) avec des solutions comme PI System et la plateforme Connect constitue un levier puissant pour concilier pilotage de production et sobriété énergétique. En s'appuyant sur des jumeaux numériques de procédés fondés sur la simulation avancée et les données en temps réel, les industriels peuvent optimiser leurs opérations, réduire leur consommation d'énergie et anticiper les dysfonctionnements.
Covestro, leader mondial des matériaux polymères, a ainsi réduit de 30 % sa consommation énergétique et de 39 % ses émissions de CO₂ par tonne de produit, avec un objectif de -50 % d'ici à 2030. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'analyse en temps réel via PI System, la simulation dynamique avec APS, et une priorisation des investissements selon leur impact énergétique.
AGC Chemicals a combiné PI System et APS pour modéliser ses procédés complexes. Résultat : une amélioration de 6 % de l'efficacité énergétique du gaz combustible, soit une économie annuelle d'environ 400 000 $, tout en maintenant un haut niveau de production.
Chez Bayer, APS a permis de réduire de 70 % l'empreinte carbone d'un principe actif pharmaceutique, en optimisant le recyclage des solvants et en réduisant d'un tiers le temps de distillation, diminuant ainsi la consommation d'énergie et les déchets.
Ces exemples concrets démontrent que l'intégration d'APS dans un environnement connecté à la donnée en temps réel transforme durablement les opérations industrielles, en alliant performance, résilience et efficacité énergétique.
Le partenariat avec Protium annonce une réduction attendue de 5 à 10 % des émissions CO₂ supplémentaires pour 256 000 tonnes grâce à vos solutions. Comment mesurez‐vous cet impact ?
Guillaume Vray : La collaboration d'Aveva avec Protium, un développeur d'hydrogène vert basé au Royaume-Uni, illustre de manière très concrète la façon dont les outils numériques permettent de mesurer et de réduire les émissions de carbone. L'objectif de Protium est d'économiser 256 000 tonnes de CO₂ par an en fournissant de l'hydrogène vert à grande échelle. Protium a choisi le logiciel d'Aveva comme colonne vertébrale de sa plateforme numérique pour générer une réduction supplémentaire de 5 à 10 % des émissions de CO₂. C'est l'optimisation de la conception des procédés et des consommations d'électricité, essentiellement réalisée sur la base des données, qui permet cette réduction supplémentaire et rend la production d'hydrogène encore plus économe en énergie.
Protium et Aveva ont établi des indicateurs de performance concrets pour mesurer la réduction des émissions de CO₂. Au niveau du temps de simulation des procédés : les solutions d'Aveva ont réduit de 30 % le temps consacré, accélérant ainsi les itérations de conception. Cette mesure indique des cycles d'optimisation plus rapides et donc une identification plus rapide des configurations économes en énergie.
La plateforme numérique a par ailleurs amélioré la fiabilité du système de 15 %, ce qui signifie moins d'arrêts imprévus des opérations ou moins de perte d'efficacité. Une fiabilité accrue garantit un fonctionnement optimal de l'usine, évitant ainsi les arrêts/redémarrages inutiles, alors sources de consommation d'énergie ou d'émissions supplémentaires.
Quant aux objectifs de maintenance : à l'aide de l'analyse prédictive, le système a identifié des opportunités de réduction des coûts de maintenance de 15 %, favorisant une utilisation plus efficace des équipements (les actifs bien entretenus consomment moins d'énergie). Des indicateurs tels que le temps moyen entre les pannes et les dépenses de maintenance sont suivis pour valider ces améliorations.
Enfin, pour ce qui est du suivi des émissions de CO₂, Protium surveille les émissions de CO₂ par unité d'hydrogène produite. En observant cet indicateur avant et après l'optimisation, ils peuvent quantifier les tonnes de CO₂ évitées grâce au logiciel Aveva. Dotée d'un jumeau numérique des opérations, la plateforme de données intégrée offre une visibilité en temps réel de la consommation d'énergie et des émissions, ce qui permet à Protium de vérifier que la réduction supplémentaire de 5 à 10 % est obtenue dans les conditions industrielles réelles.
Pour valider l'opérationnalité industrielle, le jumeau numérique d'Aveva développé pour Protium ingère en permanence des données opérationnelles (pressions, températures, consommation d'énergie) et les compare à des modèles optimaux. Le système peut par exemple détecter si la consommation d'énergie dépasse les prévisions et alerter les opérateurs pour qu'ils interviennent. Il garantit également l'intégrité et la traçabilité des données, avec un suivi certifié de l'origine de l'électricité verte prouvant que l'hydrogène est bien produit à partir d'énergie renouvelable. La clarté des indicateurs définis dans le cadre de ce partenariat avec Protium démontre l'impact du logiciel Aveva : cycles d'ingénierie plus rapides, fiabilité améliorée, réduction vérifiée des coûts et des émissions de CO₂ liées aux opérations courantes.
PI System apporte la supervision en temps réel, Asset Information Management structure la donnée. Pouvez‐vous illustrer un cas d'usage où cette combinaison a généré un gain significatif en performance ou en réduction CO₂ ?
Guillaume Vray : Combiner les données opérationnelles en temps réel (PI System) à une gestion structurée des données issues des actifs peut améliorer considérablement les performances tout en réduisant les émissions de sites industriels.
Prenons l'exemple des usines de fabrication de Toyota Motor Europe où le système PI d'Aveva a été déployé pour identifier les gaspillages d'énergie et optimiser les procédés. Dans le cadre d'un programme étalé sur cinq ans, Toyota a fait d'une pierre deux coups en réduisant de 28 % les émissions de CO₂ de ses usines européennes et de 35 % ses coûts énergétiques à l'aide d'un jumeau numérique. Celui-ci a été créé sur la base d'un modèle de données unifiées des installations de Toyota : des capteurs sur les équipements alimentent le système PI pour une supervision en temps réel, pendant que chaque point de données est relié à des machines et des lignes de production spécifiques dans l'infrastructure de données. Le jumeau numérique a été utilisé pour simuler différentes stratégies opérationnelles pendant les heures de pause. Des moyens d'éteindre ou de ralentir certains systèmes en cas d'arrêt de production ont été découverts pour réaliser des économies d'énergie et de CO₂ pendant les périodes d'inactivité. Ces améliorations ont ensuite été validées et mises en œuvre sur d'autres sites via le système de gestion des actifs qui permet d'uniformiser les procédures et de s'assurer que chaque usine suit les nouvelles bonnes pratiques.
En agrégeant et en normalisant les données de dizaines d'usines, Toyota a identifié et localisé les consommations d'énergie inutiles (machines laissées au ralenti, paramètres CVC mal réglés…). Pour révéler des inefficacités que les systèmes traditionnels en silos ne détectent pas, l'analyse de la consommation d'énergie ne s'est pas limitée au relevé du compteur, elle a été étendue à chaque équipement et procédé.
Les résultats de chaque projet d'amélioration (économies d'énergie, réduction des émissions) ont été enregistrés dans le système PI et dans la matrice des actifs pour pouvoir être déployés à l'échelle dans une logique d'amélioration continue durable.
Ces résultats sont le fruit de l'association de la supervision des données en temps réel à la structuration des données contextuelles des actifs. Tout surveiller en temps réel, analyser les anomalies, identifier les gaspillages, et utiliser les données issues des actifs peut générer des progrès spectaculaires en termes d'efficacité (pourcentage de réductions de consommation d'énergie à deux chiffres) et d'émissions de CO₂. Utilisé en complément de la gestion des données issues des actifs industriels, Aveva PI System offre à la fois des gains de performance et des avantages en matière de durabilité.
Votre dernier rapport montre que 85 % des produits ont subi des "power bench testing" et que vous avez évalué la maturité greentech de 100 % du portfolio. Quels gains énergétiques réels cela permet‐il en production logicielle ?
Joanna Mainguy : Ces évaluations fournissent une base de référence qui repose sur des données collectées pour guider le développement futur de nos logiciels. En identifiant les applications qui ont une empreinte énergétique plus élevée ou dont le code peut être optimisé, les équipes de R&D d'Aveva peuvent hiérarchiser les mises à jour pour rendre le logiciel moins énergivore. Par exemple, si, après des tests en laboratoire, une équipe découvre qu'un certain service cloud pourrait utiliser moins de cycles CPU, le cahier des charges d'ingénierie de la version suivante inclura ce point.
Ces efforts contribuent à définir les principes d'un logiciel écologique. Nous avons par exemple déjà réduit de 4 % les émissions liées à l'utilisation de nos solutions commercialisées. Au même titre que la performance ou la sécurité, les critères d'améliorations liées à l'efficacité énergétique sont désormais explicitement pris en compte dans la conception des nouvelles versions de notre logiciel. Ce travail a déjà influencé notre feuille de route à travers des tâches concrètes telles que l'amélioration du profil énergétique de la solution X ou l'intégration d'une technologie plus verte Y. De plus, lorsque nos développeurs découvrent et procèdent à de nouvelles améliorations sur notre logiciel, elles se traduisent en de réels gains pour les clients qui consomment alors moins d'énergie pour réaliser les mêmes tâches de calcul.
Dorénavant, Aveva s'assure que chaque mise à jour contribue à diminuer les émissions de carbone liées à l'informatique, ce qui aide nos clients à réduire l'empreinte environnementale liée à l'utilisation de nos logiciels.
Vous maintenez une réduction de 93 % de vos émissions Scope 1 & 2, et avez des ambitions pour le Scope 3. Comment vos outils aident‐ils vos clients à réduire leurs émissions indirectes ?
Joanna Mainguy : Nous travaillons sur les émissions du Scope 3 d'Aveva en donnant à nos clients les moyens de se décarboner. Des fournisseurs aux opérations en passant par les clients, notre logiciel permet de visualiser et d'accéder à l'ensemble des informations de la chaîne de valeur pour identifier et s'attaquer aux inefficacités à l'origine des émissions. Concrètement, les industriels réduisent leurs émissions indirectes (Scope 3) en utilisant notre logiciel pour améliorer l'efficacité, réduire les déchets et permettre une meilleure prise de décision dans les usines et les chaînes d'approvisionnement.
Alors qu'Aveva a déjà réduit sa propre empreinte carbone de 93 % (Scope 1 et 2), c'est bien notre empreinte technologique qui a l'impact le plus positif. En effet, lorsque nous permettons à des clients comme Covestro de réduire de 30 % les consommation d'énergie d'usines chimiques ou à des constructeurs automobiles mondial mondiaux tels que Toyota d'éliminer 28 % de CO₂ de leurs usines, cela montre l'impact de notre technologie. Si ces réductions se produisent dans les scopes 1 et 2 de nos clients, elles se retrouvent dans le scope 3 d'Aveva. Nous mesurons et traitons activement ces résultats pour réduire les émissions indirectes dans les chaînes d'approvisionnement et les sites industriels du monde entier.
Zydeco (ZGlobal), une entreprise du secteur de l'énergie, a économisé des milliers de dollars sur ses achats d'électricité en agrégeant des données provenant de plusieurs sources via le Data Hub d'Aveva, notre solution d'optimisation de chaîne d'approvisionnement qui permet une meilleure prévision de la demande et une meilleure gestion des stocks. Ils ont pu économiser des coûts, mais aussi consommer moins d'énergie pendant les périodes de pic de consommation d'électricité (souvent corrélés aux pics d'émissions de carbone), réduisant ainsi indirectement leur empreinte carbone. Des scénarios comme celui-ci montrent la pertinence des données connectées qui permettent de traquer les émissions indirectes évitables, que ce soit en achetant de l'énergie plus propre ou en travaillant avec des partenaires pour minimiser une activité à forte intensité de carbone.
Pour quantifier l'impact positif d'Aveva, nous développons de nouveaux indicateurs, comme le chiffre des "émissions économisées et évitées" qui mesure essentiellement la quantité de CO₂ que nos clients (et par extension leurs chaînes d'approvisionnement) ont pu éviter d'émettre grâce à nos solutions. En nous basant sur des données fiables, notre objectif est de rendre tangible la quantité d'émission de CO₂ qu'une meilleure planification ou une maintenance optimisée permet d'éviter dans les chaînes d'approvisionnement.
Aveva promeut un modèle "mandater-valider-collaborer" via les données partagées avec les partenaires, EPC et fournisseurs. Comment gérez-vous les enjeux de gouvernance, sécurité et propriété intellectuelle ?
Joanna Mainguy : Le modèle "mandater-valider-collaborer" d'Aveva encourage les entreprises à accélérer l'innovation durable en brisant les silos et en partageant avec les partenaires de leur écosystème (sociétés d'ingénierie, fournisseurs, sous-traitants), ouvertement mais de manière sécurisée et règlementée, les informations opérationnelles. Concrètement, notre plateforme assure la gouvernance (qui peut voir quoi), la sécurité (données cryptées et contrôlées par accès) et la séparation des adresses IP le cas échéant. En réglant les problèmes liés aux questions de concurrence et de sécurité, Aveva permet aux entreprises de se concentrer sur un des enjeux clés du partage des données : relever conjointement le défi de la durabilité.
Pour les entreprises et en particulier pour les propriétaires d'actifs, la première étape ("mandater") consiste à imposer des normes et des règles de partage de données communes. Les solutions cloud d'Aveva telles que Connect sont particulièrement adaptées puisqu'elles fournissent des espaces sécurisés et contrôlés par des autorisations pour l'échange de données. L'étape suivante ("valider") consiste à valider la cohérence des données, leurs plus-values, et à maintenir la confiance. Il s'agit de démontrer que le partage des données permet de gagner en efficacité ou en durabilité. La dernière étape ("collaborer") consiste à favoriser une collaboration totale tout au long de la chaîne de valeur via le partage des données pour innover conjointement. Prenons l'exemple de Veolia Water Technologies, qui a connecté 260 équipes d'ingénieurs sur le cloud d'Aveva : l'entreprise a amélioré de 20 % la collaboration tout comme son agilité à l'échelle mondiale.
Dès sa création, notre modèle a trouvé des adeptes : des secteurs comme le captage du carbone (Aker Carbon Capture/SLB Capturi), les services publics (Ontario Power, Veolia) et les matériaux de pointe (Talison Lithium) ont démontré que la collaboration basée sur le partage des données permet de réduire sensiblement les émissions et les coûts. Géographiquement, les régions dotées de fortes cultures de consortium (Europe, Amérique du Nord) sont en tête, mais compte tenu des pressions climatiques mondiales, ce modèle se répand. La gouvernance et la sécurité sont de réelles priorités pour Aveva : elles ont été intégrées à notre écosystème collaboratif pour donner à tous les participants la confiance que requiert le partage des données, et ainsi, permettre à l'ensemble des parties prenante de remporter de plus grandes victoires face au défi de la durabilité.
Vous avez lancé un badge pour les partenaires ayant démontré un impact durable. Quels sont les critères et les bénéfices tangibles à la clé ?
Joanna Mainguy : En effet, notre badge Sustainability Impact Partner récompense les partenaires (intégrateurs de systèmes ou consultants) qui font progresser le développement durable de manière proactive and concrète dans les projets industriels. Les partenaires qui ont obtenu ce badge ont démontré et documenté l'impact durable que leurs solutions apportent. Pour recevoir le badge Sustainability Impact Partner, un partenaire doit aller au-delà du statu quo et démontrer clairement qu'utiliser la technologie Aveva lui permet d'aider les entreprises industrielles à améliorer leur empreinte environnementale. Les études de cas ou les résultats de projets présentés doivent inclure des gains mesurables en matière de durabilité (pourcentage de réduction de la consommation d'énergie, émissions de CO₂ évitées, réduction des déchets, amélioration de l'efficacité, etc.). La technologie Aveva doit être délibérément exploitée pour atteindre ou dépasser les objectifs de durabilité définis par le client. Au-delà de projets isolés, les partenaires doivent faire preuve d'un engagement continu en matière d'offre de solutions économes en énergie sur la durée, car le fait d'avoir une mission et un portefeuille de solutions au service d'une industrie durable est également pris en considération dans l'évaluation.
Les entreprises industrielles perçoivent le propriétaire d'un badge Sustainability Impact Partner comme un partenaire capable d'apporter des avantages et progrès réels et vérifiés en termes d'empreinte environnementale et d'efficacité dans les déploiements de nos solutions. Concrètement, les porteurs du badge ont une véritable plus-value : ils peuvent se rendre dans une usine et la faire fonctionner plus proprement et plus intelligemment grâce aux logiciels Aveva. Pour les entreprises industrielles, ce programme met en évidence les experts incontournables en matière de stratégies et pratiques numériques industrielles durables qui favorisent un impact positif sur l'environnement et le climat. En faisant appel à un partenaire détenteur du badge, le client bénéficie des meilleures pratiques déjà testées et éprouvées dans l'industrie, ce qui permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Les solutions de ces partenaires (comme un SCADA optimisé ou un programme de maintenance prédictive) ont souvent un impact sur le long terme qui génèrent des réductions d'énergie et d'émissions année après année.
Hydrogène vert, e-fuels, stockage de carbone : quelles innovations préparez-vous dans ces domaines ?
Joanna Mainguy : Dans les domaines de l'hydrogène vert, des e-carburants et du CCUS ("Carbon Capture, Utilisation and Storage"), les innovations à venir d'Aveva se répartissent dans trois catégories.
D'abord, il y a les jumeaux numériques et les modèles de simulation développés pour être parfaitement adaptés à ces procédés. L'idée est de mettre à disposition un outil qui permet de tester et d'optimiser les procédés sans attendre des années de fonctionnement physique.
Ensuite, il y a les partenariats avec les pionniers et leaders du secteur comme Protium pour l'hydrogène, Aker Carbon Capture/SLB Capturi pour le CCUS, et diverses entreprises énergétiques dans le SAF (e-fuels). Ces partenariats nous permettent de nous assurer que les outils que nous développons sont pertinents pour résoudre les défis du monde réel. Ces collaborations sont souvent à l'origine de projets pilotes qui font avancer la technologie : nous avons par exemple créé une plateforme numérique d'hydrogène avec Protium, et aidé à concevoir l'une des premières installations de CCUS à grande échelle.
Enfin, l'innovation passe également par des projets d'améliorations technologiques ciblées. Il s'agit principalement de développement organique dans les domaines de l'analytique, de l'IA et de l'intégration du cloud. Par exemple, les innovations d'Aveva en matière d'IA appliquée au contrôle des opérations permettront de prédire les défaillances des électrolyseurs et d'optimiser automatiquement la chimie de capture du carbone. Pour l'intégralité de la suite logicielle d'Aveva, nous nous concentrons sur l'ajout de fonctionnalités spécifiques à chaque domaine.
En renforçant ainsi le portefeuille de solutions numériques d'Aveva, nous positionnons l'entreprise comme un acteur central de la transition vers de nouveaux systèmes énergétiques. Notre objectif est clair : faire de Connect la référence des plateformes d'intelligence industrielles pour les usines d'hydrogène vert, les raffineries d'e-carburants et les projets de capture de carbone. Avec notre suite logicielle qui permet de réduire les risques inhérents à l'innovation, Aveva participe activement à l'accélération du développement de ces nouvelles technologies critiques pour le climat, ce qui ouvre de nouvelles voies de croissance pour nos activités dans l'économie de l'industrie durable de demain.