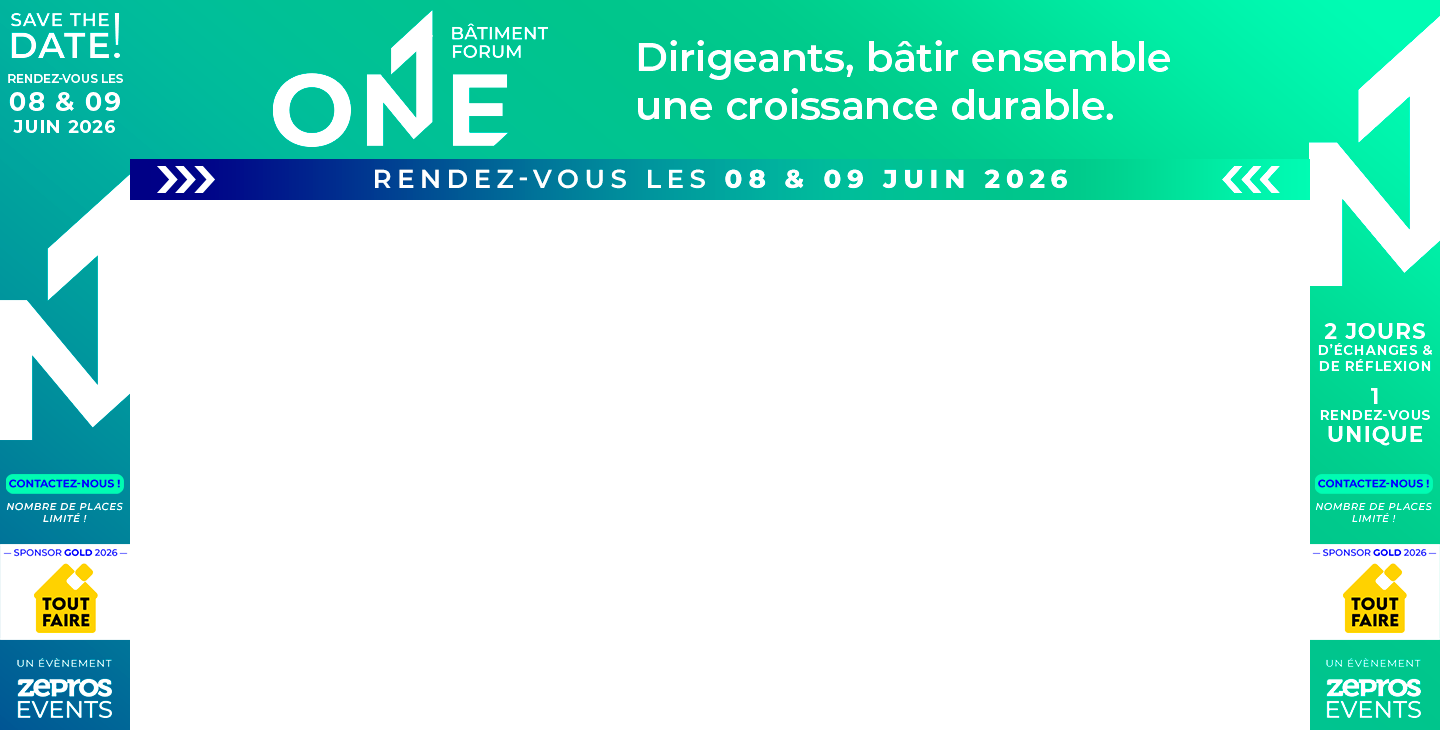Les polluants se concentrent davantage dans les espaces confinés et de plus en plus étanchés. La ventilation revêt donc un aspect primordial dans la santé et le confort des utilisateurs de ces bâtiments, qu’il s’agisse d’habitat ou d’immeubles de bureaux. Lors du Salon de l’immobilier d’entreprise, des représentants du CSTB et d’Artelia ont présenté les résultats de leur collaboration sur ce sujet, débutée au début de 2019.
Corinne Mandin, chef de division au CSTB, a notamment évoqué l’outil de modélisation Mathis-QAI : « C’est une simulation du bâtiment qui permet de prédire la qualité de l’air intérieur, à la fois pour les gaz et les particules, et de tester différents matériaux ou stratégies de dépollution, y compris sur du long terme ». L’informatique est en effet capable de mener des essais virtuels sur des périodes d’une année entière avec différentes saisons, là où les campagnes de mesures réelles ne dépassent jamais 2 ou 3 mois. La puissance de calcul autorise de multiplier les variantes et de s’assurer que les valeurs maximales de polluant ne sont jamais atteintes, quelles que soient les conditions. « Le modèle s’appuie sur un bilan matière des émissions et sur le renouvellement d’air, qui tient compte de l’étanchéité et de la ventilation mécanique. Mais également sur la taille des ouvrants, leur position, la température et l’humidité, le vent… », ajoute la spécialiste. Par rapport à l’autre solution française déjà existante, Indalo d’Octopus Lab, Corinne Mandin précise : « Nous sommes peut-être plus performants sur l’aéraulique du bâtiment et moins sur les interactions chimiques », une donnée qui a de l’importance notamment dans le cas du formaldéhyde, très réactif. Les deux logiciels coexisteront donc en 2020, lorsque Mathis-QAI sera commercialisé. De son côté, Artelia se concentre sur l’élaboration d’une méthodologie de commissionnement de la qualité de l’air intérieur, se déclinant sur toutes les phases d’une opération immobilière. Europe Mortier, responsable du pôle Conception Environnementale du groupe, détaille : « Une mission commence par un état des lieux de la qualité de l’air extérieur. Vient une étape de modélisation de la qualité de l’air intérieur puis de formulation des préconisations. Il y a ensuite le suivi du chantier puis des mesures in situ et enfin, un plan d’actions correctives si nécessaire ».